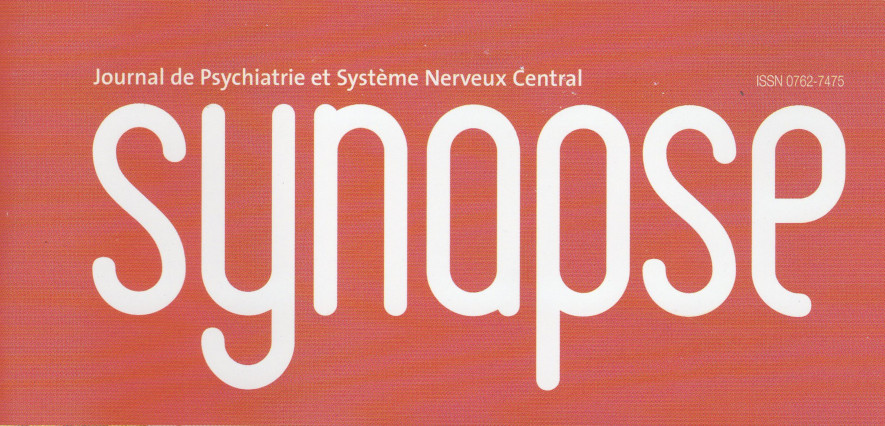Article paru en novembre 2005, dans le numéro 219 de Synapse - Journal de Psychiatrie et Système Nerveux Central
Débattre aujourd’hui du thème de la sexualité de la personne déficiente intellectuelle est toujours une gageure. À partir de 1980, en ce qui nous concerne, sous l’égide de Handicom, nous avons organisé des congrès internationaux, participé à des sessions de formation continue, publié des synthèses cliniques, collaboré avec le milieu associatif... mais que reste-t-il aujourd’hui de ces initiatives pilotes ? Sans doute un “bruit de fond”, à la fois indéchiffrable et persistant, qui, joint à l’évolution actuelle des courants de pensée, nous permet de nous retrouver aujourd’hui autour d’une table ronde. Plus généralement, mais de façon disparate et confidentielle, cela fait grosso modo une trentaine d’années qu’en France médecins et professionnels réfléchissent à la position éthique, pédagogique et clinique des soignants et des familles face à l’équation : sexualité + handicap = 0...
Avant d’entrer dans le vif du sujet, deux remarques préliminaires me paraissent utiles. Il est intéressant de rappeler que cette propension à la visibilité (d’autres diraient l’exhibition) des besoins universels d’amour, de plaisir, de construction familiale et de procréation, est liée à un vaste mouvement idéologique qui prend racine dans les années 1950 aux États-Unis. Je définirais le concept de modernité de la seconde moitié du vingtième siècle comme étant caractérisé par une forte poussée de sécularisation de la culture occidentale. En d’autres termes, est “moderne” toute conception de l’être humain qui fonde son existence, ses devoirs et ses droits, sur la base d'une légitimité détachable des dogmes religieux, quels qu’ils soient. Cette concurrence entre la primauté de l’étayage spirituel de la morale et un discours rationnel et matérialiste, n’est pas une nouveauté en Occident, mais elle a pris une violence de type révolutionnaire avec la découverte des techniques scientifiquement validées de contraception, d’interruption de grossesse et de procréation médicalement assistée... C’est de cette controverse, aussi subversive que vulnérable, que sont issues la sexologie et son approche humaniste. Il n’est donc pas étonnant d’observer que l’émergence de la “question sexuelle” des personnes handicapées soit, parmi tant d’autres sujets à polémique, contemporaine de cette récente mondialisation de la laïcité. Le second préambule est d’ordre... linguistique. Si le bien-fondé du débat d’aujourd’hui ne peut plus être contesté, craignons qu’il soit amoindri par les faiblesses de la langue française. Dès lors qu’il s’agit de signifier ce qui distingue la sexualité de procréation et les conduites sexuelles à but ludique, le vocabulaire fait défaut. En français courant en effet, le mot sexualité couvre un champ sémantique bien trop étendu pour n’être pas
suspecté de compromission avec les idées reçues. L’usage consensuel d’un terme unique pour désigner tant de manières de ressentir, tant de disparités des rituels amoureux, est une astreinte insupportable et hypocrite. Car enfin, de quoi parlons-nous, quel concept, quelles conceptions du destin “sexuel” de la personne handicapée mentale souhaitons-nous discuter, en faisant transiter notre savoir et nos convictions par une prise de parole aussi trompeuse ?
Sexualité ne désigne en réalité, à “demi-mot”, que les rituels plus ou moins amusants qui assurent la pérennité du genre humain ; l’autre aspect, celui qui énonce ce qui sexuellement fait jouir, est laissé en toile de fond, à contre-jour, en suspens, parce que tabou, indicible.