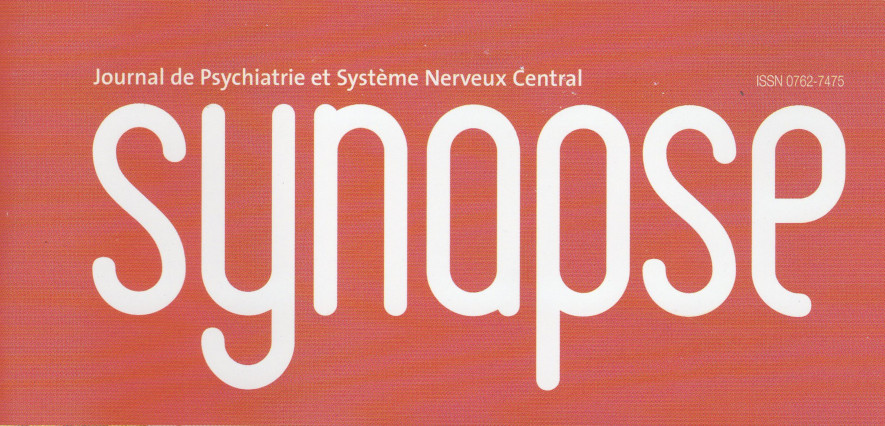Vous avez dit… sexiatre ?

La méthode Karezza, le hygge du sexe
26 mai 2019
Sexualité et handicap mental : le degré zéro de l’érotisme ?
11 janvier 2020Article paru dans "Le Monde" du 21 nov. 1988.
Invité parmi d'autres spécialistes à débattre de la sexualité des Français sur le plateau de Jean-Marie Cavada, le docteur Jacques Waynberg, attaché à l'hôpital Saint-Antoine de Paris, directeur de l'Institut de sexologie, plaide pour le développement d'une nouvelle approche et discipline, la sexiatrie.
Vous avez dit… sexiatre ?
Le sens commun du mot « sexologue » renvoie à la pratique d'un exorcisme visant à ruiner les démons qui hantent les lits conjugaux, mais, avouons-le, sans jamais réussir à purifier totalement les étreintes et les spasmes de l'angoisse de l'échec… Oh ! je sais, mieux vaudrait ne pas tenter de comprendre comment on en jouit, ne pas s'installer dans les coulisses de l'exploit, découvrant les trucages des scénarios et le trac des solistes, mais c'est trop tard, la curiosité humaine étant ce qu'elle est, il devient nécessaire d'apprendre à sous-titrer l'art érotique. Depuis près d'un siècle, la sexualité devient « sujet » d'observations et de sollicitudes sanitaires sous les auspices d'une « sexologie » (le terme « Sexualwissenschaft » est proposé en 1908 par Iwan Bloch) sur laquelle la médecine nord-américaine réussit une OPA dans les années 60, avec l'appui de W. Masters et de Mme Johnson. Le bon sens populaire donc ne tâtonne pas : la sexologie, c'est SOS-sexe, vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; le sexologue est un guérisseur.
Ainsi, depuis une trentaine d'années, l'étude scientifique des comportements sexuels et de leur organisation biologique est-elle dominée par une idéologie curative − Hippocrate contre Socrate − et définie comme « science appliquée » au sauvetage de la sexualité en péril. À l'évidence, la tutelle de l'obligation de guérir à laquelle se soumettent les « sexologues » débouche sur une boulimie de pratiques conjuratoires, mais surtout tyrannise la recherche fondamentale en privilégiant les découvertes médicalement « rentables ». Un exemple : la récupération des études physiologiques récentes portant sur le rôle de la modulation des mécanismes métaboliques, seuls responsables en fin de compte du déclenchement et du maintien de l'érection, a conduit les praticiens à prescrire des « auto-injections » de produits vaso-actifs dans les verges rebelles ou répudiées… Cette systématisation de la réponse « opérationnelle » à tout prix (les effets secondaires à long terme de ces piqûres des corps caverneux ont-ils été mesurés ?) pose déjà des problèmes d'éthique, mais illustre aussi, par la richesse de ses ornements médiatiques, l'âge baroque d'une discipline encore à l'essai.
Or, à la veille du troisième millénaire chrétien, les utopies manquent de souffle, le comportementalisme anglo-saxon s'enlise dans le retour en force du puritanisme conservateur ; l'affirmation de soi égoïste et chimérique ne représente plus une « lecture » de l'humanité…
La première tentation consiste à envisager la création d'un mouvement « antisexologique » à l'instar, on s'en souvient, de l'expérience antipsychiatrique d'un R.D. Laing dans les années 70. En effet, une relecture des échanges interpersonnels, qui harmonisent les communications érogènes, s'impose et doit assujettir l'ensemble des sexothérapies. Il n'est plus convenable de laisser la « pratique » avoir le dessus sur la théorie, l'empirisme des promesses de guérison en imposer au bon sens, le tête-à-tête médecin-malade traiter la sexualité en parent pauvre de l'urologie ou de la psychiatrie… La « sexologie » contemporaine se fourvoie dans une dialectique sommaire de la carence de performance, carence que la médecine aborde sur fond de causalité linéaire primaire et généalogique (telle démonstration de lésions artérielles « explique » la survenue d'une impuissance et « justifie » l'indication de techniques curatives) et qu'une vision étonnamment asexuée du sexe désincarne et déshumanise.

Photo illustrant l'article du Monde du 21 novembre 1988 : Vous avez dit… sexiatre ?
Du point de vue historique, l'étape d'une polémique, dont les arguments s'appuient sur une autre approche de la clinique, peut être « économisée », tout simplement en enrichissant les hypothèses et les techniques, sans en modifier la vocation. Puisque le « sexologue » fait grincer des dents à se présenter comme le savant-à-tout-faire, appelons-le sexiatre. La sexiatrie, c'est la discipline qui explique et soigne les troubles de la fonction érotique. Mais en changeant le titre, il faut aussi changer le style. L'essentiel tient comme toujours, dans l'histoire des sciences humaines, à l'ardeur de l'autocritique : la sexiatrie ne peut pas automatiquement prolonger la « sexologie » d'antan si les professionnels ne comprennent pas qu'il faut bouder les suggestions de la société de consommation, censurer l'imposture du pouvoir médical. En accouchant de la sexiatrie, la sexologie s'agrandit mais conserve la gérance des pratiques cliniques. Donc, on ne démolit pas, on ravale.
Désormais, l'immense champ d'exploration de la sexualité humaine peut reconquérir les philosophes et les anthropologues, les poètes et les paléontologues, les clercs et les psycho-sociologues, les démographes et les biologistes… qui n'envisageaient pas d'être nommés « sexologues » en dépit de leur compétence et de leurs recherches sexologiques. L'enjeu désormais est considérable : que ceux qui savent un tout petit quelque chose à propos du sexe n'aient plus honte de bâtir une sexologie.
À chacun ses besognes et ses récompenses. Ne sera plus sexiatre qui veut ; ne peut plus être sexologue qui l'envie. Le métier va être plus exigeant. C'est comme en amour, plus c'est difficile, plus c'est exaltant. Le comble de la « sexologie de papa », c'est qu'on courait le risque de s'y ennuyer.